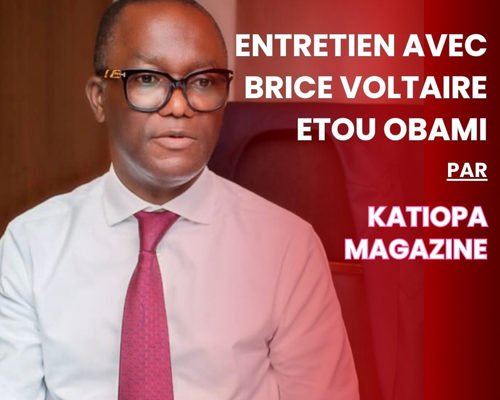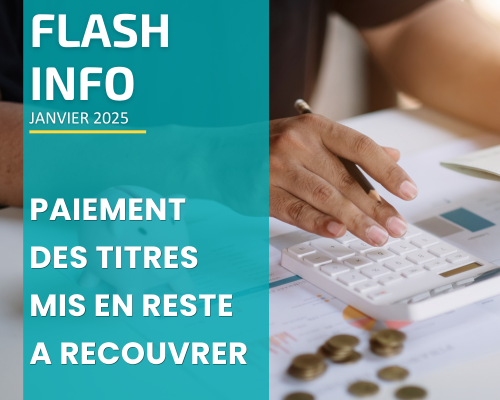Le 14 mai 2025, le magazine Katiopa a consacré un entretien avec Brice Voltaire Etou Obami, fondateur des cabinets Exco Cacoges et CCJF. L’article, publié en Une sous le titre « Brice Voltaire Etou Obami : maître de l’audit, gardien de la conformité », a été rédigé par Prince Bafouolo.
Katiopa Magazine est le média de référence du Bassin du Congo. Sa vocation est de mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent pour le développement de cette région, considérée comme le deuxième poumon écologique du monde, tout en étant une force de propositions et de changement.
Le magazine a publié ce qui suit :
Figure incontournable du monde de l’expertise comptable en Afrique centrale, Brice Voltaire Etou Obami (BVEO) incarne un modèle de rigueur, d’innovation et d’engagement multidimensionnel. Expert-comptable agréé CEMAC (EC n°389) et commissaire aux comptes, il dirige les cabinets Exco Cacoges et CCJF basés à Brazzaville. Depuis 2024, il est accrédité en passation des marchés publics et projets de développement international par l’ESG UQAM (Canada). Nous l’avons rencontré à Paris pour évoquer son parcours.
Prince Bafouolo a souligné l’humilité remarquable de Brice Voltaire Etou Obami. Après avoir brièvement évoqué l’actualité de l’Église Kimbanguiste, dont il est un membre de premier plan, il a abordé ses activités professionnelles, notamment sa carrière à l’international et son sursaut patriotique. Il a également évoqué son engagement littéraire ainsi que sa transmission de la foi religieuse.

1. Carrière internationale et sursaut patriotique
Brice Voltaire Etou Obami a commencé sa carrière en 1999 au Congo, avant de s’envoler vers la France où il a rejoint le prestigieux cabinet Ernst & Young (EY). Par la suite, en Belgique, il a occupé les postes de Senior Manager et de Team Leader sur des projets de développement international au sein du même cabinet. Dans ce cadre, il a coordonné des missions d’audit pour des institutions multilatérales, des États et des ONG dans plusieurs pays d’Afrique, notamment en Guinée équatoriale, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal et en République Centrafricaine.
En 2009, il a choisi de quitter le contexte international pour revenir au Congo, motivé par une volonté forte :
« Je voulais contribuer à la modernisation du système financier de mon pays et de mon continent. »
Brice Voltaire Etou Obami
C’est dans cette optique qu’il a fondé Exco Cacoges, un cabinet qui s’est rapidement imposé comme un acteur clé dans des secteurs stratégiques tels que la banque, le pétrole, les télécommunications et les industries extractives. Membre du réseau international Kreston Global, Exco Cacoges est un cabinet pluridisciplinaire intervenant notamment dans l’audit des entreprises extractives et pétrolières, le conseil stratégique aux institutions publiques et privées, la conduite de missions d’assistance à la privatisation, ainsi que la certification et la normalisation des procédures comptables. Il est également fondateur du cabinet Exco Congo qui fournit des services professionnels en conseil et expertise comptable et du cabinet de conseil juridique et fiscal CCJF crée en juillet 2019.
Fort de plus de 26 ans d’expérience, BVEO a construit sa réputation en accompagnant entreprises et institutions publiques dans des audits complexes, des missions de conseil stratégique et des processus de privatisation. Il a notamment contribué au renforcement des dispositifs de contrôle interne, en particulier dans le secteur bancaire, ce qui a permis de renforcer la solidité des institutions financières de la zone CEMAC.
Agrée comme commissaire aux comptes par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) et par la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF), il a mené plusieurs missions d’audit, notamment celui de la dette publique de la République du Congo de 2003 à 2013, l’audit de certification des recettes pétrolières, ainsi que ceux de la compagnie aérienne Ecair et du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Dans la sous-région, il a également réalisé l’audit de la dette de la Guinée équatoriale et celui du programme de Restauration de la justice à l’Est du Congo (Rejusco) à Goma, en République Démocratique du Congo.
2. Engagement littéraire, transmission et foi religieuse
Auteur reconnu, BVEO a publié plusieurs ouvrages de référence, tels que « Problématiques et solutions aux différentes questions juridiques, fiscales et sociales : cas pratique », « Comptabilisation et audit des coûts pétroliers dans une société non opératrice » ou encore « Les fondamentaux de la consolidation et de la combinaison en référentiel SYSCOHADA révisé ». À travers ces publications, il exprime sa volonté « de former et de transmettre son expertise aux nouvelles générations de professionnels africains ».
Il est également enseignant permanent à l’Institut Supérieur de Gestion (ISG), où il dispense des modules sur l’audit légal, la consolidation, l’audit des coûts pétroliers et la gouvernance.
Son engagement ne se limite pas au domaine professionnel : il occupe la fonction de président délégué du collège exécutif national de l’Église kimbanguiste en République du Congo, où il joue un rôle actif dans la vie religieuse et sociale, notamment au Congo et en RDC. Il est également conseiller principal de « Sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l’Église Kimbanguiste ».
Le 18 avril 2024, en tant que vice-président du comité de suivi et d’évaluation du « projet Koundzoulou », il a accueilli le président de la République, Dénis Sassou Nguesso, lors de sa visite du site agropastoral de Koundzoulou à Ngabé, dans le département du Pool. Initié par l’Église Kimbanguiste avec le soutien du Chef de l’État congolais, ce centre vise à développer l’agriculture et l’élevage sur une superficie de 98 000 hectares.
En résumé, l’article de Katiopa Magazine a présenté en détail la vie et le parcours de Brice Voltaire Etou Obami, mettant en lumière une personnalité respectée pour son engagement professionnel, social et spirituel. À ce jour, il reste une figure de premier plan dans le domaine de l’audit dans le Bassin du Congo.
Tous les collaborateurs d’Exco Cacoges, d’Exco Congo et du CCJF sont fiers d’avoir un président et un leader aussi compétent et engagé. Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour son dévouement et son humanisme.